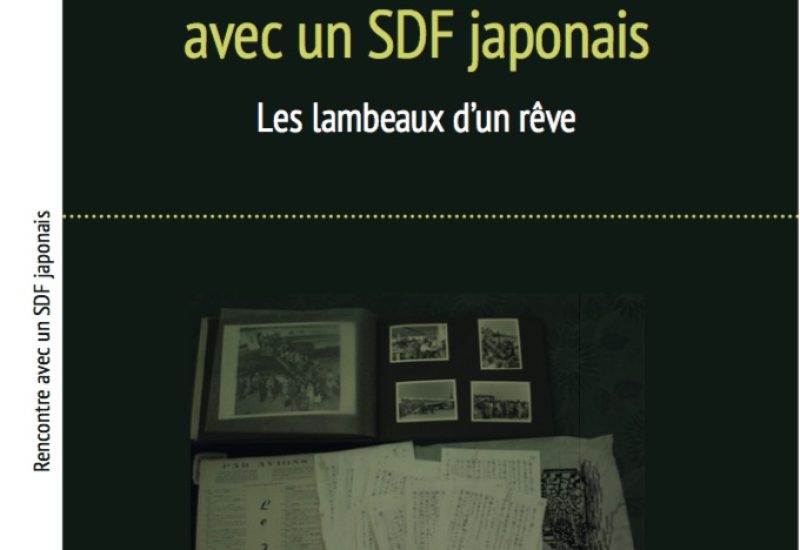Cette étude porte sur les années précédant 1906. Avant cette époque le processus de contact entre le Japon et les Arabes ainsi que l’islam montrait que le domaine des connaissances sur cette sphère culturelle était dans un état de friche complet. Rares étaient les livres écrits par les Japonais sur ces sujets pendant la période des Tokugawa, ou même avant, et les bribes de connaissances sur la sphère arabo-islamique étaient toujours imprécises[i].
Quatre cent quarante-trois (443) œuvres, articles et documents ont été écrits ou édités au Japon durant l’ère Meiji traitant de l’islam, du monde arabe et du Moyen-Orient. Je me suis basé pour effectuer ce travail sur l’étude faite sous la direction de Pr. Miura Tôru, professeur à l’université Ocha-no-mizu, parue sous le titre: Nihon ni okeru chûtô bunken mokuroku 1868-1988, (Bibliographie des études sur l’Islam et le Moyen-Orient au Japon de 1868 à 1988)[ii]. Il se peut que cette liste ne soit pas exhaustive, mais tous les arabisants japonais pensent que cette étude a fait le tour complet de tout ce qui a été écrit sur ce sujet.
Comme pour toutes les autres acquisitions de connaissances dans le Japon moderne, il est évident que l’ère Meiji représente une étape charnière et primordiale. Or à cette époque une double approche s’est imposée pour toutes les connaissances que le Japon acquiert, indépendamment des domaines concernés: d’une part il faut se pencher sur le “contenu” de ces disciplines, et d’autre part analyser les moyens (ou média) de leur diffusion, les discours qui ont accompagné l’arrivée de ces connaissances, leur réception, leur assimilation et enfin leurs apports à la formation du concept que se fait le Japon du monde arabo-islamique.
Il faut ajouter aussi que la connaissance elle-même est une notion assez ample et inclusive, qui assemble des comportements touchant le domaine des sciences cognitives, des pratiques de l’apprentissage, la mise en place des disciplines, l’élaboration des théories et l’établissement des institutions qui doivent mettre en œuvre, d’une façon cohérente, l’assimilation par la société de ces connaissances.
Or une des singularités de cette acquisition de connaissances sur le monde arabe au Japon est son aspect horizontal et extra-temporel, et cela contrairement aux autres connaissances dont l’acquisition est verticale et temporelle. Par acquisition horizontale est visée une acquisition massive de tous les aspects touchant à cette culture et civilisation arabe et islamique, acquisition qui s’est effectuée sur une courte période, donc extra-temporelle, alors que l’acquisition verticale est progressive dans le temps, et les connaissances s’emboîtent, se succèdent, se transforment et s’autorégulent au fur et à mesure de leur acquisition, donc temporelle.
La cadence de parution des textes sur l’islam et le monde arabe entre 1868 et 1906, montre une accélération de ces éditions à partir de 1896, donc après la victoire du Japon sur la Chine. La courbe accélérée et brute de ces acquisitions interdit, en effet, toute prise de distance et assimilation progressive.
Par la suite, après la date limite retenue pour le graphe n°1 (1906) (où est il ?), le nombre progressa évidemment de façon encore beaucoup plus importante (si on a 160 textes entre 1868 et 1906, nous avons pour les six dernières années de Meiji 283 articles et textes).
Pour autant, ce n’est pas la quantité des ouvrages et articles qui donne une indication sur la dynamique des connaissances sur le monde arabo-musulman au Japon, mais plutôt l’ensemble des idées et des données informatives qui vont structurer la manière dont les Japonais ont pensé cette sphère culturelle et, de là, l’islam et la pensée arabe.
Cela nous conduit à voir le problème de la lisibilité (au sens large d’intelligibilité) de ces textes par rapport aux horizons d’attentes de leurs lecteurs que sont les Japonais de cette époque. C’est de cet aspect de l’acquisition de connaissances que nous allons présenter.
Car si cette acquisition permet en effet au Japon de rattraper le manque de connaissances sur une partie du monde, il est néanmoins évident qu’elle était influencée par les sources occidentales qui furent à l’époque les seules sources sur le monde arabo-islamique vers lesquelles les Japonais se sont tournés. Vint s’ajouter à tout cela la rapidité, en termes de temps mesurable en années, avec laquelle furent acquises ces connaissances.
Nous constaterons que tous les textes ont une approche occidentale du monde arabo-musulman et un point de vue occidental pour le décrire.
Prenons le texte “ Nichiro sensô to Morokko jiken ” (La guerre russo-japonaise et l’incident du Maroc) écrit par URABE Momotarô, publié dans “ Le bulletin de l’Université Keiô ” à Tôkyô le 15 juillet 1905 [note x][iii]. Dans cet article plusieurs phrases montrent de façon éclatante cette transmission du point de vue occidental au lecteur japonais, sans aucune nuance ni altération.
L’avant-dernier paragraphe du premier chapitre, par l’information qu’il comporte, nous permet une datation exacte d’un de ces emprunts du point de vue occidental. Il est dit (concernant le Maroc): “Le système judiciaire est très imparfait; l’égalité qui doit présider à l’esprit des jugements n’existe pas, même les Juifs et leurs malices et intrigues ne peuvent échapper à cette injustice.” (Les caractères en gras ne sont pas autorisés)
Il va sans dire que cette dernière phrase tirée d’un article écrit au Japon en 1905, reflète l’ambiance du phénomène de l’antisémitisme régnant en Europe à cette époque. L’auteur cherche à convaincre son lecteur japonais de la cruauté du système royal marocain de cette époque. Pour cela, il utilise une argumentation qui relève de critères spécifiquement occidentaux (européens) : l’antisémitisme qui connut son apogée durant ces années en Europe. L’auteur utilise dans son argumentaire un outil rhétorique décrit par Aristote sous le terme de pathos, qui est l’ensemble des émotions que l’orateur ou l’écrivain cherche à provoquer chez son destinataire. Or le destinataire de ces écrits, le lecteur japonais, ne pouvait pas avoir à cette époque de sentiment, ni de ressentiment à l’égard des juifs comme c’était le cas en Europe. Et nous sommes en droit de nous demander ce que le lecteur japonais de cette époque, qu’on cherche à convaincre de la dureté des conditions de vie au Maroc, connaît des clichés qu’on attachait aux Juifs en Europe comme stéréotypes négatifs.
L’auteur de cet article s’est contenté de copier, il faut le dire, un argumentaire destiné à un lectorat européen, et le relayer à un lectorat japonais. Cet énoncé informatif rencontrait l’horizon d’attente du lectorat européen (occidental) parce qu’il était compréhensible par lui. Mais cet énoncé est au Japon au-delà de l’horizon d’attente du lecteur japonais, donc incompréhensible.
D’après le linguiste Jean-Michel Adam: “Raconter, (pour notre cas écrire) c’est toujours raconter (écrire) quelque chose à quelqu’un à partir d’une attente (bienveillante ou méfiante), sur la base d’un horizon d’attente...”[iv]. Cet horizon étant fondé, toujours d’après Adam, sur “… l’acceptabilité interactionnelle (valeur, intérêt, à propos, pertinence) de ce qui est raconté”. Jauss également définit la notion d’horizon d’attente en tant que “système de références propres aux lecteurs”[v].
Il est évident que cette valeur antisémite n’existait pas dans le système de références propre aux lecteurs japonais, donc n’était pas incluse dans l’horizon d’attente du récepteur japonais. Mais, pour la société japonaise de l’époque Meiji, toutes les informations en provenance de l’Occident et touchant à des domaines inconnus d’elle, ce qui était le cas pour les connaissances sur le monde arabo-musulman, étaient considérées comme des données indiscutables avec une valeur scientifique. Une donnée informative occidentale était considérée comme une endoxa suivant la définition d’Aristote: “…ce sont des idées admises… des opinions partagées par tous les hommes ou presque, ou par ceux qui présentent l’opinion éclairée…”. Les données informatives en provenance de l’Occident, semblaient ainsi être considérées comme des idées endoxales.
Il est évident que le phénomène de réception de ces données informatives en provenance de l’Occident a laissé des traces sur la construction de la vision que les Japonais auront sur de nombreux sujets.
L’autre phénomène palpable est celui de la diffusion de données informatives sur des sujets (ici c’est l’islam) sans que le récepteur japonais ait le bagage de connaissances nécessaire pour une bonne réception. C’est dans les premiers textes concernant la religion musulmane que ce phénomène est le plus frappant.
Dans un article intitulé: “Les origines de l’islam d’après Tisdale” (Kaikyô no hongen Tisdale ni yoru), paru aussi dans Le bulletin de l’Université Keiô le 15 février 1901 (idem)[vi], nous trouvons un exemple de ce phénomène.
Avant cet article, seuls huit (8) livres avaient été publiés entre 1875 et 1901. Parmi ces livres, la moitié traite des religions dans le monde, dont l’islam. Ces livres étaient loin de couvrir tous les aspects de cette religion (leurs volumes varient entre 33 pages pour le plus petit et 300 pages pour le plus imposant). Les autres quatre livres parlent surtout de Mohamed et de sa vie. Donc les “données informatives” sur l’islam étaient rares, même dans les milieux “cultivés”. Et comme nous l’avons vu, les écrits sur l’islam avant Meiji étaient rares sinon inexistants, on peut déduire que la connaissance de cette religion parmi les Japonais de cette époque était minime.
Donc cet article paru en 1901, qui est le neuvième texte par ordre de parution, dont le titre “Les Origines de l’islam” peut attirer des lecteurs avides d’informations de façon générale, et sur cette religion en particulier. L’auteur reprend sous forme de fiche de lecture un livre, sorti en Europe, dont le sujet est un des plus polémiques, y compris entre les islamologues eux-mêmes.
Ce livre contrairement à ce que laisse supposer le titre, n’explique pas les origines de l’islam, mais traite de plusieurs questions touchant aux fondements de l’islam, et cela à travers l’analyse d’une série de légendes. Ces questions polémiques (car il faut le dire elles remettent en cause la vérité des dires de Mohamed le prophète sur plusieurs aspects de cette religion) qui sont intéressantes d’un point de vue théologique, ont accompagné la naissance et la propagation de l’islam. Elles étaient très en vogue en Europe, mais aussi dans le monde arabe et en terre d’islam. Les faits rapportés et utilisés en tant qu’éléments argumentifs ont toujours fait l’objet de polémiques et d’études. Mais si en Europe et dans les pays musulmans ces légendes faisaient l’objet d’analyses et de débats, cela se passait dans des milieux et dans un environnement ayant derrière eux treize siècles de connaissances de l’islam. Des livres mettant en doute les fondements de l’islam étaient édités depuis longtemps en Europe, sachant que ces livres sortaient en parallèle à d’autres livres allant dans un sens inverse de cette critique de l’islam, ce qui permettait au débat d’avancer et aux recherches sur l’islam de se développer de façon scientifique.
Or le Japon de cette époque ne possédait pas ce bagage scientifique concernant l’islam. D’ailleurs le deuxième livre dans la série sur l’islam “La Vie de Mohamed” écrit par Humphrey Prideaux qui fut traduit par Hayashi Tadasu en 1876, est un des livres les plus critiques qui soit sorti sur l’islam. Et les biographes de Prideaux n’hésitent pas à le considérer comme un livre qui “met en évidence, en s’appuyant sur une énorme érudition, les plus mauvaises opinions sur le caractère de Mohamed”.
S’il est normal donc d’avoir ce genre de livre critique sous un horizon d’attente ou le récepteur a une compréhension (bienveillante ou méfiante) comme décrit par Adam, il semble hasardeux scientifiquement, d’entamer une ouverture sur une science et la connaissance d’une sphère culturelle aussi large que celle des pays musulmans par des livres des plus polémiques. Et cela, surtout dans une société où, comme on l’a vu, ces données informatives sont au-delà de l’horizon d’attente des récepteurs.
La traduction met en évidence un autre aspect de la production des textes que nous avons étudiés, et qui nécessite une attention particulière de notre part. Dans les textes traduits apparaît clairement l’emprunt effectué en Occident de ces connaissances sans qu’il y ait au Japon une base de compétence linguistique ou culturelle qui permettait une compréhension de ces textes. La plupart des oeuvres et des articles a été traduite en japonais à partir d’une langue occidentale (surtout l’anglais et le français, parfois l’allemand). L’opération de traduction, c’est à dire l’opération d’encodage et de décodage des données relatives au monde arabe et à l’islam, a été réalisée sans la compétence linguistique et culturelle dans ces domaines. Or, comme le dit Charles Bouton, l’opération traduisante est une : “Interprétation des signes d’une langue au moyen des signes d’une autre langue“[vii]. Selon la théorie structuraliste : chaque langue est un ensemble de systèmes qui ne connaissent que leur ordre propre, et forme un tout unique. Le traducteur doit donc constamment faire intervenir dans l’opération traduisante deux niveaux de systèmes d’analyse. Le premier système se situe au niveau des signifiés en fonction de l’idéation notionnelle (contrôle extra-linguistique) de la référence qu’il interprète. Ce niveau peut être schématisé par :
a (énoncé en langue/origine) = b (concept) = c (énoncé en langue cible).
Alors a = c.
Pour les textes en question, le concept (b) est la signification déterminée de termes arabes ou islamiques dans le pathos des traducteurs de textes concernant le monde arabe ou l’islam en langues occidentales, et il était des plus aléatoires chez les traducteurs japonais de l’époque.
Le deuxième système est une opération plus elliptique des transcodages, elle se situe au niveau des signifiants et se ramène à un savoir-faire empirique évitant le “mot à mot” de la traduction que peut supposer le premier système. Cette démarche complexe combinant les deux systèmes a été résumée par Bouton comme suit :
(énoncé-langue/origine)=>(référent+idéation)=>(énoncé-langue cible)
Alors il est légitime de s’interroger sur le savoir empirique à savoir : l’idéation et l’ensemble des référents (concernant la culture arabe et l’islam), que possédaient les traducteurs japonais de cette époque (qui traduisaient à partir de langues occidentales) pour éviter le mot à mot déformateur de sens et de significations. C’est au niveau des référents et de l’idéation que se trouvaient les points faibles que font apparaître les textes étudiés.
Ce qui nous intéresse ici c’est le système “encodage/décodage” où il y a la mise en jeu de toute la dimension de l’acquis préalable (aptitude à comprendre et sensibilité) des formulations idéologiques (concernant la culture arabe et l’islam). C’est cette formulation idéologique qui semble absente de ces textes et qui limite les horizons de la compréhension, chez le traducteur/auteur au départ puis chez le récepteur (lecteur) à l’arrivée. La traduction étant une discipline qui relève de différents niveaux de compétence individuelle impliquant la linguistique, mais aussi qui dépasse les opérations de simple transcodage. Elle implique en fait, surtout dans le domaine du religieux (islam) et du culturel (civilisation arabo-islamique) des problèmes complexes de signification.
Pour les textes qui font l’objet de la présente étude, l’absence dans l’opération traduisante des relations entre langue et milieu apparaît de façon claire, et des relations bien plus complexes entre langue et pensée, langue et représentation du monde. Mais aussi est tangible l’effet du double passage par le système “encodage-décodage”. Les textes ou les idées (données informatives) contenues dans ces textes étaient véhiculés dans la “langue originale” (arabe en général). Ces idées furent décodées par l’Occident et par la suite encodées dans la langue cible: une des langues occidentales (anglais ou français surtout). Puis durant la deuxième opération traduisante d’une langue occidentale, qui devient une langue originale pour le traducteur (japonais) vers la langue japonaise langue cible, ces idées ont été décodées à nouveau (de la langue occidentale) pour être encodées ensuite dans la langue cible le japonais. Il est évident qu’il y a une perte inéluctable dans le degré de la signification entre le point de départ du signifiant et le point d’arrivée du signifié dans toute opération traduisante par le faite de l’opération décodage/encodage. Dans le cas d’une opération avec un double passage, la perte de la signification ne peut qu’être plus importante. En se fiant, dans la première période d’ouverture du Japon, uniquement aux ouvrages traduits et à la traduction d’ouvrage de langues occidentales vers le japonais, pour rencontrer la culture arabo-islamique, l’orientalisme japonais de cette époque a accumulé, par la multiplication des opérations encodage/décodage, ce décalage des valeurs de signification des données informatives portées pas ces ouvrages.
Comme nous l’avons déjà vu, le lecteur japonais n’avait pas les compétences nécessaires pour une compréhension du sens original des données informatives sur les Arabes, la culture arabe et l’islam. Pour les auteurs et traducteurs japonais ils étaient en train de “ traiter ” des textes occidentaux. Décrivant ce phénomène, Nishio Tetsuo écrit sur la réception des Mille et une nuits au Japon : “ … les valeurs européennes, associées aux Nuits au dix-neuvième siècle, qui donnèrent des versions comme celles de Townsend et Lane, furent adaptées à celles en vigueur au Japon à cette époque, avec pour conséquence qu’une des valeurs essentielles des fonctions littéraires des Milles et une nuit (…) disparut. Les Nuits avaient perdu leur capacité à représenter un texte par lequel les lecteurs pourraient comprendre le monde arabe ou les cultures du Moyent-Orient”[viii]. Il continue décrivant la première traduction faite par Nagamine Hideki (1848-1927)[ix] de ce livre-phare de la littérature arabe[x]: “ Nagamine semble considérer les Nuits comme appartenant à la civilisation européenne, que l’on cherchait ardemment à imiter pendant l’ère Meiji ”.
[i] ) TAYARA Bassam, Le Japon et les Arabes, Paris, Médiane, 2004, 200 p.
[ii] ) Nihon ni okeru chûtô bunken1868-1988, Bibliographie des études sur l’Islam et le Moyen-Orient au Japon de 1868 à 1988, Tôkyô, Tôyô bunko, 1992, 787 p. + index 144 p.
[iii] ) URABE Momotarô, Nichiro sensô to Morokko jiken, La guerre russo-japonaise et l’incident du Maroc, Keiô gijuku Le bulletin de l’Université Keiô, Tôkyô, 15 juillet 1905, Keiô gijuku daigaku (Les Editions de) Université Keiô, N° 92 p. 30 à 39.
[iv] ) ADAMS Jean-Michel, Le Récit, Paris, Presses Universitaires de France, col. “Que sais-je?”, 2001, 128 p.
[v] ) JAUSS Hans Robert, Pour une esthétique de la réception, Paris, Gallimard, 1978, 272p.
[vi] ) Kaikyô no hongen Tisdale ni yoru, Les origines de l’islam d’après Tisdale35, Keiô gijuku Le bulletin de l’Université Keiô, Tôkyô, 15 février 1901, Keiô gijuku daigaku (Les Editions de) Université Keiô, N° 36 p. 56 à 58 .
[vii] ) BOUTON Charles, La Linguistique appliquée, Paris, Presses Universitaires de France, col. “Que sais-je?”, 1993, 124 p., p.60.
[viii] ) NISHIO Tetsuo, “Les Mille et une Nuits et la genèse littéraire de l’orientalisme au Japon”, Les Mille et une Nuits en partage, sous la direction de Chraibi Aboubakr, Paris, Sindbad (Actes Sud), 2004, 524 p.
[ix] ) Nagamine Hideki (1848-1927) professeur d’anglais au collège de la marine japonaise (Kaigun heigakkô), il a traduit de nombreux livres de l’anglais, parmi lesquels nous trouvons L’Histoire générale de la civilisation en Europe de Guizot, ainsi que beaucoup d’ouvrages scientifiques.
[x] ) Anonyme (traduction de) Nagamine Hideki
(kaikan kyôki) bôyo-monogatari, (Introduction aux merveilles) Le roman des nuits des secrets (Les Mille et une nuits), Tôkyô, 1875, Vol. 1, 40 p. & Vol. 2, 46 p.